| Avis à la population | 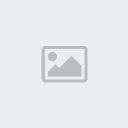 |

Pendant longtemps l’idée de prendre plaisir à se baigner semblait saugrenue. La mer était une ennemie, au mieux une indication thérapeutique. Les bains de mer ne deviennent à la mode qu’au XIXe siècle.
La mer, mauvaise et mangeuse d’hommes…
Peuplée de monstres, labourée de tempêtes, la mer fait peur depuis des millénaires. Le Moyen Âge imagine l’océan comme une frontière du monde, la peste arrive par les bateaux, les naufrageurs rôdent sur les côtes, les pirates et les orages en pleine mer, la mort est partout. Les villages en bord de côtes sont souvent plus agricoles que marins.
« Il y a trois sortes d’hommes, écrivait Victor Hugo, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer ». Personne n’apprenait à nager, pas même les matelots : pourquoi s’épuiser à nager en cas de naufrage à une époque où, faute de radio, personne ne vient à votre secours…
La mer, c’est bon pour les malades !
Le seul bon côté de la mer, en dehors bien sûr de la nourriture qu’elle offre, ce sont les vertus que lui prêtent les médecins. Au XVIe siècle, on prescrivait les bains de mer contre la rage ! Les malheureux malades se voyaient délivrer un certificat pour obtenir le libre passage aux frontières de Bretagne ou du Poitou et gagner l’Atlantique à temps…
L’idée que les bains de mer sont, plus largement, bons pour la santé de tous et qu’ils vivifient le corps naît au XVIIIe siècle en Angleterre. Les Français de la bonne société imitent bientôt les Anglais. Le premier établissement de bains de mer en France se crée, en face des côtes anglaises bien sûr, à Boulogne, en 1790. Le phénomène s’amplifie après les troubles de la Révolution et de l’Empire, dans les années 1820.
L’essor des villes balnéaires au second Empire
L’essor véritable date du second Empire, car un réseau ferré tout neuf s’étend en France et gagne les côtes. Période faste pour les plages ! Bien sûr, on continue à parler médecine, les vertus thérapeutiques de l’air iodé sur les enfants malingres sont confirmées en 1861, l’impératrice Eugénie inaugure un « hôpital maritime » en 1869 (on parlerait aujourd’hui de thalassothérapie)… mais on vient désormais aussi par plaisir.
D’abord un tourisme chic
Ces premiers touristes ne savent pas nager. Pas question de s’éloigner du bord : on se trempe tout habillé, en marchant dans la mer. Pas question non plus de bronzer, c’est vulgaire !
On s’abrite du soleil sous des ombrelles, on garde son chapeau et on ne reste que peu de temps sur la plage : tennis, casinos, belles villas ou stades hippiques offrent d’autres distractions.
Les plages du Pas-de-Calais sont les premières à prendre leur essor : Boulogne (qui passe de 7 800 habitants en 1801 à 46 000 en 1898), Wimereux, Berck, Le Portel… Les côtes normandes suivent, car elles sont proches de Paris (le train ne va qu’à 60 km/h au mieux) : Deauville est créée par le duc de Morny (demi-frère de Napoléon III) dans les années 1860 sur des marais sableux, Cabourg attire aussi la bonne société, suivent Houlgate, Dives, Merville-Franceville…
En Loire-Atlantique, Pornichet reçoit ses premiers hôtes vers 1860, Camille Flammarion y lance une « plage des libraires » qui reçoit le monde littéraire. Quant à La Bôle, devenue La Baule, réservée d’abord aux malades, elle attire bientôt la société la plus en vue, organise des fêtes et des courses (hippiques d’abord, automobiles à partir des années 1920).
La côte atlantique devient ainsi touristique au fur et à mesure de l’avancée des voies ferrées. Dans les Pyrénées-Atlantiques, c’est l’impératrice Eugénie qui lance la mode, car la côte basque lui rappelle ses souvenirs d’enfance. À partir de 1854, elle fait de Biarritz la station balnéaire la plus chic du monde, où les maharadjahs côtoient les princes et les rois !
La Côte d’Azur, lancée par les Anglais (toujours eux !) à la fin du XIXe siècle plus la Bretagne suivent à leur tour.
Quand on se met à nager…
Au XXe siècle, ceux qui viennent sur les plages se mettent à nager… dans des maillots de bains ressemblant à des robes arrivant à mi-mollet pour les dames, des maillots et caleçons longs pour les hommes car il n’est pas question que la vue des baigneurs puisse choquer les passants !
Enfin, les congés payés, en 1936, permettent à une population élargie de venir « voir la mer » et profiter des plages. Mais ceci est une autre histoire…
Texte : Marie-Odile Mergnac
